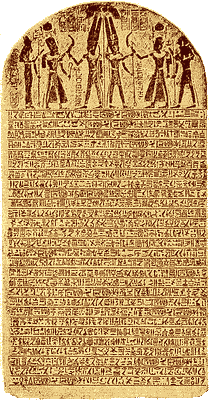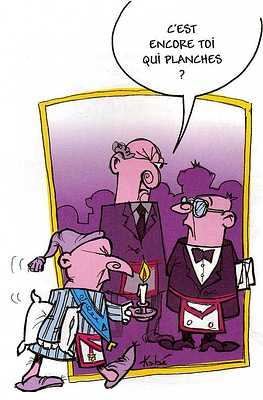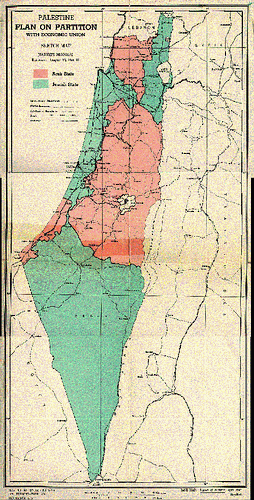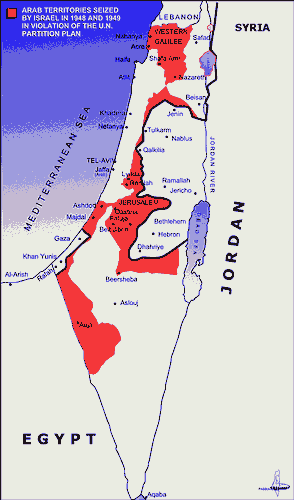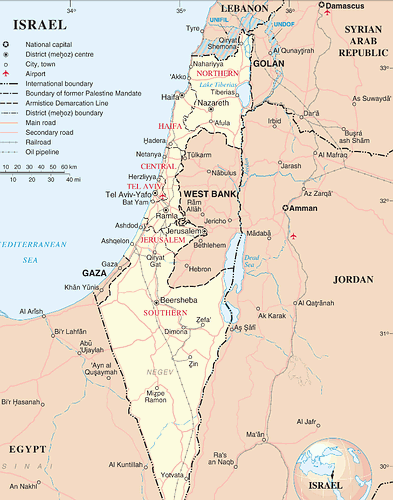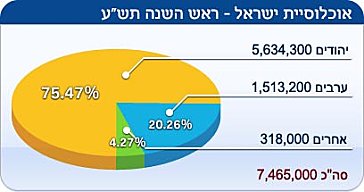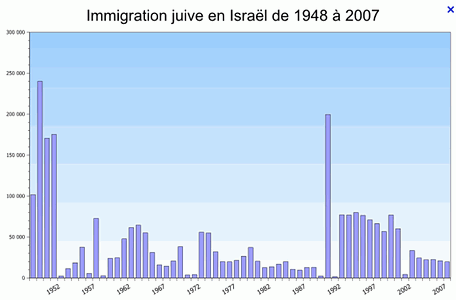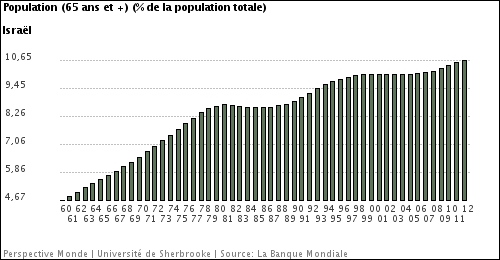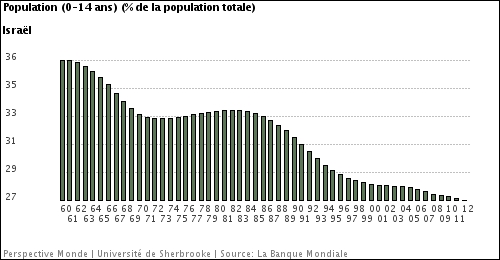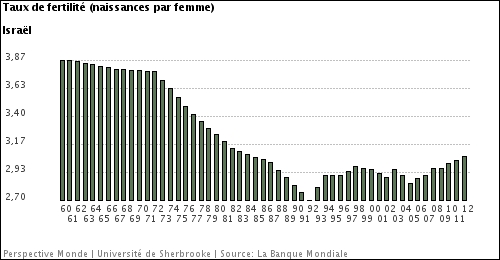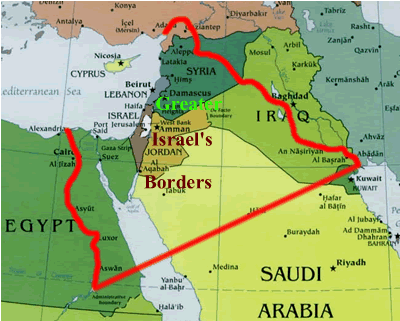LA VIE
EN ISRAËL
- LE POIDS DE LA RELIGION
Lors de la création de ce nouveau pays, il a fallu trouver un
large consensus entre les différentes composantes du peuple juif
: kibboutzims socialistes, sionistes, ultra-orthodoxes, etc. Ces derniers
ont exigé de conserver leurs us et coutumes, à savoir
l'existence des yechivoths, écoles où les hommes étudient
le talmud (pendant que leurs femmes travaillent, comme on peut le voir
dans le film « Kadosh »). Ces hommes sont dispensés
de service militaire, encore aujourd'hui. Ces ultra-orthodoxes ou heradim,
ce qui signifie « craignant Dieu », sont terrifiés
à l'idée de violer une des 613 mitzvots ou commandements.
Ils s'opposent à la rédaction d'une Constitution. Pour
eux, créer un état juif sans le Messie est une révolte
contre Dieu. Ils ont leurs quartiers, leurs magasins, leurs partis politiques
qui pèsent fortement dans la vie d'Israël, leurs écoles
qui sont subventionnées par l'Etat. Forte de 650 000 membres
(environ 10 % de la population israélienne), la communauté
haredi double son effectif tous les quinze ans, grâce à
une moyenne de huit enfants par foyer.
Disposant de 16 élus à la Knesset, la communauté
ultra-orthodoxe pèse lourd dans la coalition dirigée par
Benyamin Nétanyahou. Ce poids politique l'empêche de s'attaquer
aux prérogatives dont elle bénéficie.
Qu'en est-il du reste de la population ? D'après des statistiques
de 1993, je n'en ai pas trouvé de plus récentes, environ
les deux tiers des juifs israéliens croyaient en Dieu, 24% n'en
étaient pas assurés et 13 % n'y croyaient pas. Par ailleurs
la moitié pensait qu'Israël était un peuple spécialement
élu de Dieu, 29% en étaient mal assurés et 20%
n'y croyaient pas. Enfin, 39% attendaient la venue du Messie, 29% étaient
hésitants et 32% n'y croyaient pas. Précisons qu'en Israël,
il y a environ 77% de juifs, 15% de musulmans, 2% de chrétiens.
D'autres chiffres semblent indiquer un pourcentage important de hilonim,
mot souvent traduit à tort par laïc ; en réalité,
ce mot signifie « non pratiquant », ce qui n'est pas tout
à fait la même chose.
- DES PROGRÈS
La Cour Suprême est la plus haute instance judiciaire d'Israël.
Elle est à la fois une cour d'appel pour le pénal et le
civil, et une Haute Cour de Justice, siégeant en première
instance, principalement pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel
des décisions du gouvernement ainsi que pour le contrôle
de constitutionnalité des lois. Quelques exemples de ses interventions
:
- Quand la télévision israélienne est mise en service
en 1968, Golda Meir demande que les émissions soient interrompues
pendant le Shabbat. Cette décision est invalidée par la
Cour Suprême.
- En 1970, les orthodoxes proposent que les centres commerciaux restent
fermés le shabbat, en échange de l'acceptation de l'ouverture
des lieux de culture et de loisirs. Les laïcs font observer que
le compromis est sans objet. L'ouverture de ces lieux est maintenant
un fait accompli.
- Le camp religieux orthodoxe n'a pas réussi à obtenir
un amendement de la Loi du Retour par lequel seule la conversion orthodoxe
serait reconnue par l'Etat.
- La loi limitant l'importation de viande non kasher contredit les normes
démocratiques mais cela n'empêche pas de nombreux restaurants
non kasher d'avoir pignon sur rue.
- LA VIE POLITIQUE
L'Etat est juif et démocratique. Ces deux adjectifs semblent
contradictoires.
Démocratique, oui. En Israël, il y a des partis politiques,
un Parlement, des syndicats et même des loges maçonniques.
D'aucuns nient la validité d'Israël comme Etat juif au nom
des valeurs démocratiques. C'est refuser de reconnaître
dans le droit du peuple juif à l'autodétermination une
valeur digne d'être prise en compte. C'est refuser de respecter
le vote majoritaire.
L'Etat est donc juif avec pour conséquence une distinction fort
importante dans la pratique entre citoyenneté et nationalité
ou ethnicité. La diaspora juive, deux fois plus nombreuse que
les juifs habitant Israël, dispose virtuellement de la nationalité.
En revanche les Arabes, nés en Palestine, qui ont la citoyenneté
israélienne et comptent pour le cinquième de la population,
avaient une autre « nationalité », dont la mention
figurait sur leurs cartes d'identité. En 2002, la rubrique «
nation » a été bannie mais elle continue de figurer
sur les registres d'état civil du ministère de l'Intérieur.
La démocratie en Israël compte donc des citoyens virtuels
(diaspora), des citoyens complets (juifs israéliens) et des citoyens
moins complets (Israéliens arabes).
Israël n'a pas de Constitution mais un corpus de lois fondamentales
qui doivent en devenir le socle. Celle de 1958 indique que toute personne
niant l'existence d'Israël comme Etat juif et démocratique
ne peut être candidate à l'élection à la
Knesset.
Celle de 1960 régit les terres. En 1947, à la veille de
la décision de partage, 7,6 % des terres palestiniennes appartenaient
aux juifs, alors que 10 % étaient possédées et
gérées par les représentants du mandat britannique,
et que le reste était arabe.
Aujourd'hui, 92 % de ces mêmes terres appartiennent à l'Etat
d'Israël, au "Fonds des terres d'Israël" et à
"l'Autorité de développement", alors que les
Arabes palestiniens citoyens d'Israël n'en possèdent pas
plus de 3%. Et ceci, grâce à une panoplie de lois comme
celles sur les biens des absents, celle de l'expropriation des terres
de 1953, grâce aussi à la création de l'Organisation
sioniste et de l'Agence juive, qualifiées je cite d’ "institutions
habilitées à travailler en Israël pour développer
le pays et installer les immigrants de la diaspora ».
En Israël, seuls les mariages religieux (devant un rabbin pour
les Juifs, un imam pour les musulmans) sont reconnus. Le mariage civil
n'existe pas. Toutefois Israël reconnaît les mariages civils
effectués à l'étranger (en général
sur l'île voisine de Chypre).
- LES ARABES ISRAÉLIENS
Israël Beskind, l'un des premiers colons arrivés en Palestine
en 1882 était « convaincu de l'existence d'un lien historique
serré entre les habitants des temps anciens et les paysans autochtones
contemporains de son époque. » Quel est le statut de ces
arabes israéliens dans un État juif et démocratique
?
Les arabes vivant en Israël ont actuellement le droit de vote,
sauf les habitants de Gaza et de Cisjordanie qui n'ont ni citoyenneté
ni droit de vote israéliens.
En Israël, les arabes représentent environ 20% de l'électorat
et sont représentés par 3 partis qui se déclinent
comme tels. Ils obtiennent généralement 10% des sièges
à la Knesset, exceptionnellement un portefeuille ministériel
sans importance au gouvernement.
En 2009, deux partis arabes ont été interdits d'élections
car ils rejetaient la notion d'Israël comme État juif.
La proportion des arabes parmi les fonctionnaires est de 5 % alors qu'ils
constituent près d'un cinquième des citoyens. Les arabes
sont dispensés de service militaire depuis les premiers jours
de l'Etat. Aux yeux d'une partie importante de la population juive,
cette exemption affaiblit la validité de leur revendication à
la pleine égalité des droits.
Et quand on sait que l'obtention de certains avantages sociaux dépend
de l'accomplissement des obligations militaires, on comprend que cette
dispense défavorise les arabes israéliens et crée
un facteur discriminatoire.
En 2007, un arabe, Ghaleb Majadleh. est devenu ministre. Il a refusé
de chanter la Hatikvah, l'hymne israélien. Difficile en effet
pour lui de chanter « Tant qu'au fond de l'âme, les
juifs en tous lieux gardent la flamme de retourner chez eux, alors cette
espérance s'accomplira ; malgré l'errance, jamais ne mourra
». «Israël a besoin d'un nouvel hymne, un hymne que
les Arabes puissent chanter» (Bradley Burston Haaretz). Nous
pourrions ajouter qu'Israël a besoin d'un État qui ne soit
pas uniquement juif et qui prenne en compte les arabes.
L'Etat israélien reconnaît des droits culturels aux Palestiniens,
comme le droit de posséder et d'administrer leurs propres écoles
mais malheureusement cette reconnaissance fonctionne comme un vecteur
d'exclusion économique. En effet, les diplômés du
système éducationnel palestinien séparé
ne possèdent pas une connaissance adéquate de l'hébreu
alors que c'est la langue de la majorité. Sur le marché
du travail, ce handicap limite leurs chances de réussite. Autre
discrimination, (nous avons aussi les nôtres en France), l'État
d'Israël a eu du mal à intégrer les mizrahim ou juifs
orientaux, dont les coutumes étaient très différentes
de celles de leurs compatriotes, et plus proches de celles des arabes.
Les ashkénazes les appelaient «les bêtes sauvages
». L'Histoire officielle instille à leurs enfants la mémoire
« des shtelts de Russie et de Pologne ». La nôtre
inculque « nos ancêtres les Gaulois » aux
enfants d'immigrés !
- LE SYTÈME SCOLAIRE ISRAÉLIEN
Le système éducatif est divisé en 3 courants :
- L'école publique dont le programme est établi et contrôlé
par le ministère de l'Education. L'enseignement est gratuit jusqu'au
baccalauréat. L'enseignement de la Bible et de la culture juive
y est obligatoire.
- L'école publique religieuse. Même programme et dépendance
du ministère de l'Education. Mêmes avantages financiers.
Même organisation. Par contre l'enseignement religieux y est plus
poussé, les enfants étant initiés à la pratique
religieuse conformément à la tradition juive.
- Les écoles indépendantes
- religieuses : le programme d'enseignement n'est pas sous la responsabilité
du ministère de l'Education nationale. L'école est payante.
- non religieuses tournées vers un programme spécifique
comme le sport ou la musique.
A noter que la minorité ultra-orthodoxe reçoit des financements
étatiques pour ses écoles religieuses.
Le gouvernement israélien alloue également des fonds aux
écoles arabes ainsi qu'à nombre d'écoles et de
collèges musulmans. Les écoles arabes enseignent le Coran
et l'Arabe, en plus du programme général du ministère
de l'Education.
L'Université hébraïque comprend deux départements
d'histoire totalement distincts : un « département d'histoire
du peuple d'Israël et de sociologie des Juifs » et «
un département d'histoire » [...] L'histoire du passé
juif s'étudie séparément de l'histoire des «
Gentils ». A signaler : l'an dernier, le ministère israélien
de l'Education a approuvé l'existence d'une école "réservée
aux Blancs", après qu'une écolière juive éthiopienne
a été exclue de son école située dans les
territoires palestiniens occupés. Cette jeune Ethiopienne de
religion juive avait été exclue en raison de la couleur
de sa peau. Ses parents ayant protesté, ils ont eu dans un premier
temps gain de cause parce que l'école en question était
publique et financée par l'Etat. Mais les parents blancs des
74 enfants fréquentant cette école ont finalement obtenu
du ministère de l'Education que les classes de cette école
soient réservées aux Blancs ... en privatisant l'école.