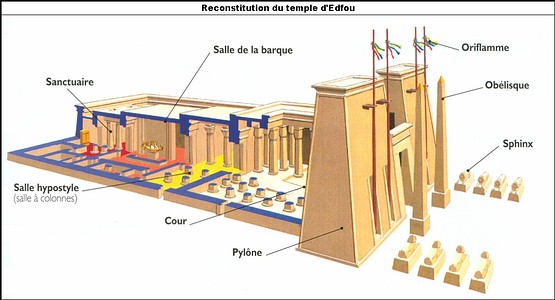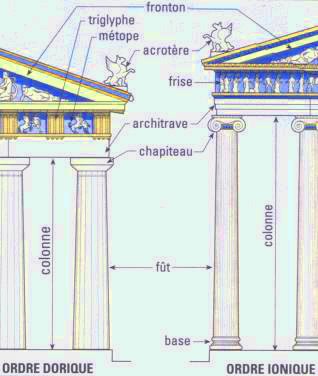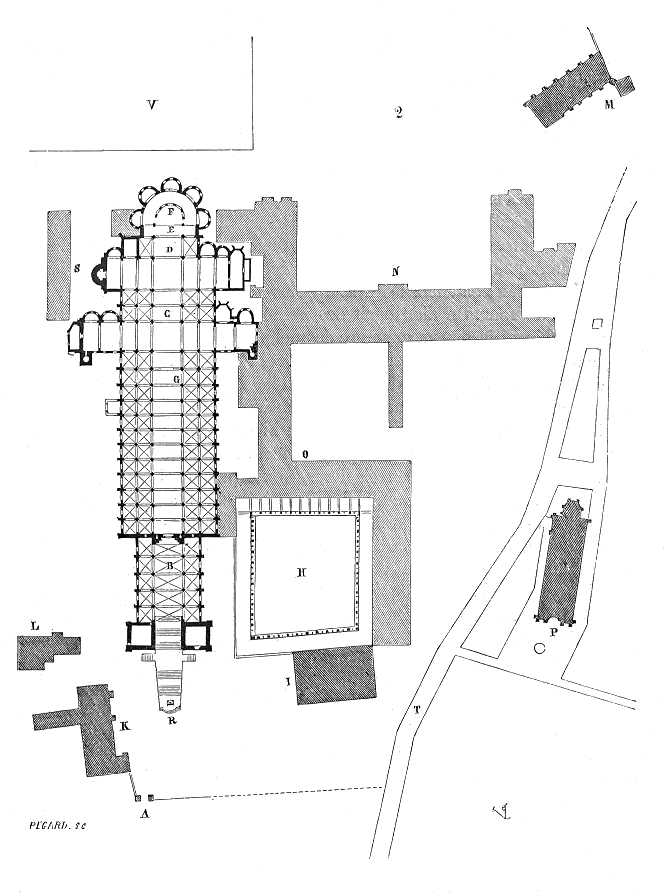De retour
des premières croisades, les croisés reviennent avec de
nouvelles connaissances, (techniques de construction, et maîtrise
de la science géométrique).
Le 12ème siècle ouvre une ère architecturale nouvelle,
riche de découvertes. Les bâtisseurs ont maintenant les
outils nécessaires pour donner à l’architecture
une dimension divine.
Ils possèdent la foi issue des règles monastiques, les
techniques de la structure, et surtout l’outil géométrique
permettant de proportionner les volumes, de dompter l’équilibre
de l’édifice en faisant cheminer les forces de poussée
des voûtes dans des endroits précis de la construction.
La période gothique va durer environ 350
ans. Pendant cette durée en Europe, le volume de pierre
mis en œuvre sera supérieur au volume utilisé en
Egypte pendant 3000 ans.
Le gothique primitif (~1140 à 1190) se dessine essentiellement
à travers deux édifices : la basilique de Saint-Denis
avec son double déambulatoire et les
croisées d’ogives, la cathédrale de Saint-Etienne
de Sens et sa voûte sexpartite.
On distingue ensuite 3 périodes: Le gothique lancéolé
XIIIème siècle, le rayonnant XIVème et le flamboyant
XVème.
Le gothique lancéolé (~1190-1250) avec
ses voûtes barlongues et ses baies en lancettes
: au Nord de la France avec Notre-Dame de Chartres
et Saint-Etienne de Bourges.
L'origine du gothique rayonnant (~1250 -1375) peut
être située à Paris, à la suite des travaux
de la basilique de Saint-Denis. La réalisation
des murs de verre prend toute son importance avec la Sainte
Chapelle.
Notre-Dame d’Amiens, Notre-Dame de Reims
ou Saint-Pierre de Beauvais, prennent immédiatement
en compte cette évolution et changent partiellement leur plan.
C'est à cette époque que la rose devient vraiment un élément
incontournable du décor.
Le gothique flamboyant (~1375-1500) avec ses décors
exubérants, s’épanouit en Normandie (Saint-Maclou
de Rouen, Saint-Germain l'Auxerrois, Saint-Etienne du Mont).
Le gothique se caractérise essentiellement par une structure
de pierre autoportante.
Les murs comme les voûtes, sont relégués au stade
de remplissage. Ils perdent leur fonction structurelle, ce qui va permettre
de remplacer la pierre par des vitraux au niveau des murs. La lumière
a une importance capitale : elle traverse des vitraux composés
de scènes bibliques et de l’histoire du peuple, faisant
office de livres ouverts.
La technique du gothique va libérer les bâtisseurs au niveau
de l’expression architecturale. Elle permet de construire de plus
en plus haut et d’affiner les éléments portants
en les contreventant dans tous les sens. La structure ou squelette reste
visible, elle devient le support à toute imagination et création
esthétique. Elle s’affranchit des techniques antiques,
elle développe sa propre identité. A cette époque,
on voit évoluer, simultanément, différents styles,
selon les écoles.
Plus on avance dans le temps, plus l’art gothique s’enrichit
jusqu’à se dépouiller totalement du chapiteau.
Les organes primordiaux structurels du gothique sont l’arc
brisé qui réduit sensiblement les poussées
latérales des voûtes, et, l’arc-boutant,
traduction du contrefort roman, parfois noyé
dans la construction. Plus le mur s’éclaircit plus le contrefort
devient saillant, étayant les voûtes sur croisées
d’ogives.
L’arc-boutant apparaît ainsi, par nécessité,
50 ans après leur construction, à Notre-Dame de Beaune,
Saint-Lazare d’Autun et Sainte-Marie-Madeleine
de Vézelay qui menaçaient de s’écrouler.
La croisée d’ogives apparaît en Normandie.
Vers la fin du XVème siècle, on voit se développer
la clef pendante, suspendue à la voûte
principale, servant de lien pour soutenir dans le vide, 2 voûtes
secondaires.
La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg démarrée
en 1015 crée une structure particulière pour gérer
sa construction et son entretien : l’œuvre Notre-Dame mentionnée
dès 1246 existante encore de nos jours. L’œuvre
Notre-Dame est chargée d’organiser les interventions
des corps de métiers œuvrant sur le chantier et de collecter
des fonds pour la poursuite de l’ouvrage.
Elle devient référence pour toutes les cathédrales
édifiées dans l’est de l’Europe.
Commencées en 1015, ses fondations uniques au monde ne furent
achevées qu'en 1028, treize ans après le début
des travaux. Il s’agit d’un socle de limon et d’argile
renforcé par des pieux en bois. C’est une technique antique
qui permet de créer une sorte de semelle stable sur laquelle
va s’élever la maçonnerie des fondations.
Terminée en 1439, la flèche de la tour nord culmine à
142,11 mètres au-dessus du sol, et c'est la
plus haute flèche construite au Moyen-Âge de nos jours
encore présente.
Notre-Dame de Strasbourg est une des seules grandes
cathédrales de France dont la tour nord est dotée d'une
flèche, typique de l'architecture germanique.
On peut noter que la flèche représentait alors, un élément
de prouesse de construction, avec lequel les bâtisseurs cherchaient
à rivaliser, dépassant parfois les 160 m.
Vers le XIIIème siècle, l’avènement
du marteau pilon hydraulique va faire évoluer
le travail du fer qui va devenir un matériau pour les liaisons
de grande dimension : chaînage pour ceinturer
l’ensemble de l’édifice, tirant
pour relier les parties fragiles à l’édifice, raidisseur
pour renforcer les vitraux, exemple : Saint-Pierre de Beauvais.
En Angleterre, la chapelle du King’s Collège de
Cambridge, terminée sous le règne d'Henry
VIII (1485/1515), affiche une longueur de 88 m et une largeur
de voûte 12 m. Sa hauteur intérieure est de 24 m. Sa voûte
en éventail est la plus grande au monde.